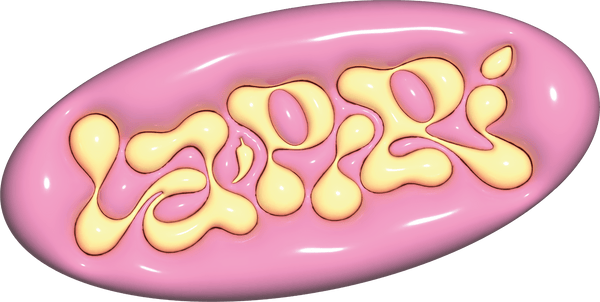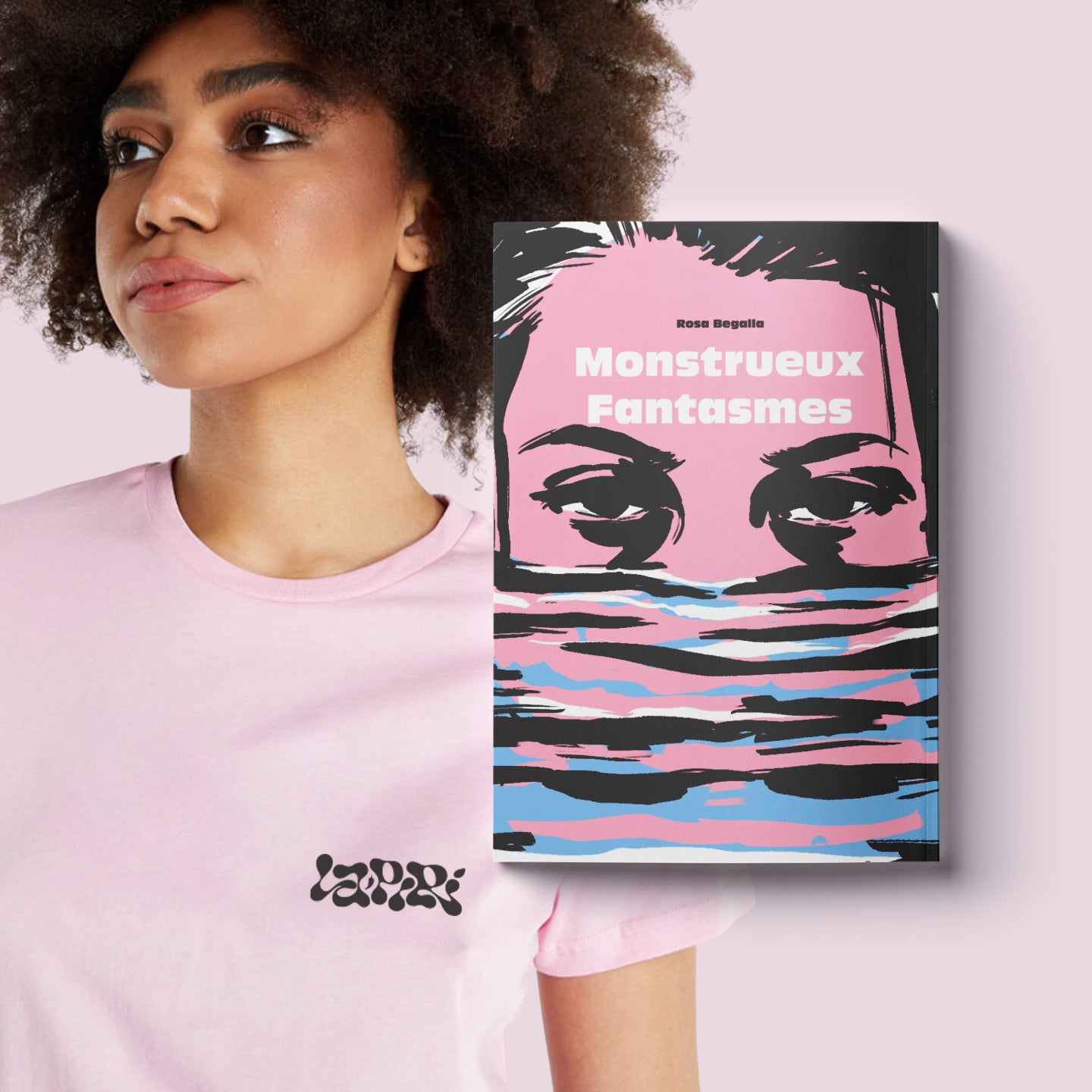P-Valley et la Gentrification des Stripclubs : Quand le Strip-Tease Devient un Luxe
Depuis son lancement, P-Valley a captivé les spectateurs avec son portrait brut et authentique de la vie dans un stripclub du Mississippi, The Pynk. Mais au-delà des danses envoûtantes et des drames personnels, la série met en lumière une réalité plus large : la gentrification des stripclubs et la transformation de ces espaces, autrefois des lieux d’émancipation pour les minorités, en clubs de luxe exclusifs.
Ayant vécu à Miami, on peut observer à quel point la ville s’est transformée, notamment après le COVID. La Floride, déjà célèbre pour ses fêtes étudiantes lors du Spring Break et l’un des rares États à ne pas avoir imposé le port du masque, est devenue un véritable eldorado pour les citadins en quête de liberté après les confinements.
Tout comme Marseille en France, Miami a vu affluer une nouvelle vague de résidents venus chercher un cadre de vie plus agréable et abordable. Pour les New-Yorkais, Miami représente ce que Marseille est aux Parisiens : la mer, la nature et un coût de la vie autrefois attractif. Mais cette migration massive a bouleversé la ville. Les nouveaux arrivants investissent et rachètent tout, faisant grimper en flèche les loyers des appartements et des commerces. Les habitants historiques, incapables de suivre cette inflation, se retrouvent contraints de partir, laissant derrière eux des boutiques et des quartiers vidés de leur essence.
Un phénomène similaire touche les stripclubs. Miami, l’une des villes les plus emblématiques de cette industrie, subit une transformation sous l’influence de ces nouveaux arrivants. Historiquement, la population de Miami est majoritairement latina (environ 70 %), suivie par une communauté noire (20 %), tandis que les Blancs sont en grande partie des touristes ou des résidents occasionnels. D’où l’expression bien connue : 'Miami, ce n’est pas vraiment les États-Unis'—une phrase qui rappelle ce que l’on dit souvent de Marseille. Aujourd’hui, les petits cafés cubains ont presque disparu, remplacés par des attrape-touristes le long d’Ocean Drive. Les nouveaux arrivants viennent non seulement pour investir, mais aussi pour profiter du cadre, se détendre en famille et s’amuser—mais toujours d’une manière plus "chic" et aseptisée.
Dans P-Valley, Katori Hall dresse un portrait sincère de la vie des strip-teaseuses, en mettant en avant leur force, leur résilience et leur autonomie. Le stripclub y est dépeint comme un lieu de pouvoir pour les femmes, en particulier les femmes noires, leur offrant une indépendance financière et un contrôle sur leur image et leur corps.
Mais cet équilibre fragile est menacé par des forces extérieures. Dans la série, The Pynk se retrouve dans le viseur des promoteurs immobiliers qui veulent racheter l’établissement pour un projet plus lucratif. Cette trame reflète une tendance bien réelle dans l’industrie : la gentrification des clubs de strip-tease.
Il y a une dizaine d'années le club 11 ouvre ses portes : un strip club dans un club. Vous pouvez aller admirer le showcase des stars les plus connues, faire la fête tout en mangeant les "meilleurs" sushis à l'étage (c'est scandaleux à quel point chaque endroit qui se veut élitiste choisit des sushis...), faire une pause avec un show d'acrobates et vous esquiver 10 minutes pour une dance privée avec une des effeuilleuses professionnelles qui arpentent le club en proposant leur service. Les auditions des danseuses sont dignes d'american idole, tout est digital et connecté, tout le monde est sur son 31 comme si c'était le Baôli...
Les anciens stripclubs ne sont "QUE" des stripclubs, "gentlemen's" club, "urban" clubs...pas de sushis mais les incontournables chicken wings, ambiance "venez comme vous êtes" (vu le nombre de mecs blancs qui rentrent en chemise hawaïenne, short et tongs en cuir...). Les danseuses sont les stars elles-mêmes (comme Mercedes dans P-valley) avec un casting très diversifié (poid, couleur de peau, nationalité, tatouages, coupes de cheveux, défauts, taille, age) qui met plus en valeur la capacité à faire de l'argent et le charisme plus que l'apparence. Et le Dj n'est pas un prestataire du club, il est au service des danseuses et organise leur passage selon les chansons ou styles musicaux qu'elles lui ont demandé de mettre pendant leur performances. On oscille ainsi entre rap, rock, reggaeton, dancehall, pop, meme hardrock selon les danseuses.
Ces stripclubs sont le baromètre des artistes et rappeurs qui testent leur musiques dans les stripclubs pour savoir si ce sera un tube selon comment les danseuses et les clients se l’approprient. La preuve est que quasi tous les rappeurs citent des stripclubs dans leur chansons (Drake parle de KOD , s'ils ne finissent pas par sortir avec leur danseuse la plus en vue (comme Tyga avec Blacc chyna à l'époque) C'est ce que montre bien la série P-Valley avec le personnage de Lil Murda, un rappeur qui cherche à se faire connaitre via le stripclub. Dans les nouveaux clubs le DJ mets des chansons pour le public sans que les danseuses puissent faire des demandes spécifiques...
La gentrification touche de nombreux secteurs, et les stripclubs n’y échappent pas. Dans de nombreuses villes, les clubs historiques tenus par des minorités sont remplacés par des établissements plus luxueux, souvent fréquentés par une clientèle aisée.
Ces nouveaux clubs imposent des critères plus stricts en matière d’apparence et de performance, excluant souvent les danseuses issues de milieux marginalisés. La diversité des corps et des styles de danse disparaît peu à peu au profit d’un esthétisme normé et d’une clientèle qui valorise l’exclusivité plutôt que l’authenticité.
Dans P-Valley, le stripclub est bien plus qu’un simple lieu de travail : c’est un refuge pour des personnages queer, des femmes noires, des immigrantes et d’autres personnes marginalisées. L’évolution de The Pynk dans la série illustre la lutte des clubs indépendants pour préserver leur identité face aux forces économiques et sociales qui cherchent à les transformer.
L’histoire de The Pynk est un écho aux luttes réelles des stripclubs aux États-Unis, où la gentrification menace non seulement les établissements, mais aussi les communautés qui y trouvent un espace d’expression et de liberté.
🔥 Conclusion
Avec P-Valley, Katori Hall nous pousse à nous interroger sur l’avenir des stripclubs : resteront-ils des lieux de pouvoir et de diversité, ou deviendront-ils des espaces réservés à une élite ? La série rappelle que ces clubs ne sont pas de simples divertissements, mais des espaces de culture, de résistance et de survie pour de nombreuses danseuses.
La gentrification des stripclubs reflète une dynamique plus large de contrôle et d’exclusion. Reste à savoir si les clubs indépendants comme The Pynk pourront survivre face à cette transformation, ou s’ils disparaîtront pour laisser place à une version édulcorée et aseptisée du strip-tease pour n'en garder que l'esthétique et le folklore.
Pour finir tout de même sur une note positive : Cette gentrification apportera peut-être la considération des autorités et forcera les clubs à rentrer dans la légalité vis-à-vis des rémunérations...Récemment à Denvers et pour la première fois 2 stripclubs viennent d'être condamnés à payer 14 millions de dollars à la suite d'une enquête du bureau de l'auditeur de Denver sur le vol de salaires.

Les enquêteurs ont découvert que plus de 230 artistes, barmans, serveurs et autres travailleurs des deux établissements s'étaient fait voler de l'argent. Les deux entreprises ont également eu recours à des pratiques douteuses sur le lieu de travail, selon le Denver Labor.
Diamond Cabaret et Rick's Cabaret doivent maintenant verser 11,358 millions de dollars de dédommagement aux travailleurs et 2,6 millions de dollars d'amendes à la ville et au comté de Denver.
« Ce n'est potentiellement que la partie émergée de l'iceberg, car cette société a retenu les dossiers de probablement 99 % des artistes », a déclaré Matthew Fritz-Mauer, directeur exécutif de Denver Labor. L'employée de longue date a déclaré qu'il était habituel que ses supérieurs lui demandent des pourboires.
L'enquête du Denver Labor a révélé que Diamond Cabaret et Rick's Cabaret avaient mal classé les artistes - strip-teaseuses ou danseuses - en les considérant comme exemptés de certaines lois sur les travailleurs. Cette classification erronée signifiait que les clubs de strip-tease ne payaient pas les artistes de manière appropriée pour leur travail.
Les clubs exigeaient également des stripteaseuses qu'elles paient un « droit d'entrée » pouvant aller jusqu'à 85 dollars par service, selon Denver Labor, et qu'ils paient un « droit de promotion » supplémentaire de 8 dollars avant de commencer à travailler. Les strip-teaseuses devaient également se produire sur scène pendant trois chansons et être torse nu à la fin de la deuxième chanson, selon Denver Labor. Elles ne pouvaient pas non plus quitter la scène avant que la danseuse suivante n'apparaisse.
« Malgré ce que ces clubs leur disent, les artistes ont les mêmes droits que tous les autres travailleurs de la ville », a déclaré M. Fritz-Mauer. « Ils ont droit au salaire minimum et il est illégal de les obliger à payer pour travailler, d'autant plus que les clubs exercent un contrôle important sur eux."
(PS: Il y avait un club sur Paris par exemple qui FORCAIT ses employées à suivre des cours de sensualité "offerts*" par le club (à des horaires impossibles, genre le mercredi à 15H pendant 1h SMH)...pour pouvoir danser dans le club, déjà c'etait lourd, mais ils écrivaient dans le contrat que si la danseuse ne travaillait pas 1 mois minimum à la suite elle devait alors rembourser les cours de sensualité prodigués en amont à hauteur de 30€ de l'heure !!!! LES FILLES en France il est illégal de payer pour pouvoir travailler. Ce n'est pas valable.
Cette pratique est illégale en France. Voici pourquoi :
-
Clause abusive : Obliger une employée à suivre une formation et exiger son remboursement en cas de départ anticipé peut être considéré comme une clause abusive, surtout si cela n’est pas justifié par un véritable engagement de formation professionnelle.
-
Travail dissimulé ou déguisé : Si ces "cours de sensualité" sont imposés en dehors des horaires habituels et ne sont pas rémunérés, cela pourrait être assimilé à du travail dissimulé.
-
Liberté contractuelle : Une salariée doit pouvoir rompre son contrat (période d’essai incluse) sans être pénalisée financièrement de manière disproportionnée.
-
Droit du travail : En France, un employeur ne peut pas imposer à une employée de financer sa propre formation obligatoire pour exercer un poste, sauf si cela est prévu par un accord contractuel clair et conforme aux lois en vigueur.
Si une danseuse a été contrainte de rembourser ces cours, elle pourrait saisir les Prud’hommes pour contester cette pratique et potentiellement obtenir un remboursement des sommes versées.
En espérant que cette revalorisation salariale du statut des strippers fasse autant parler que P-Valley ! XOXO
Source: https://www.denver7.com/news/front-range/denver/two-denver-strip-clubs-must-pay-14-million-as-a-result-of-denver-auditors-office-wage-theft-investigation